Les droits des personnes en situation d'itinérance

Présentation de l'aide-mémoire (Durée : 2 min 53 s).
-

Réalités des personnes en situation d'itinérance
Les personnes en situation d’itinérance sont aux prises avec des facteurs de vulnérabilités qui s’entrecroisent :
- la pauvreté,
- l’instabilité résidentielle accrue par la crise du logement,
- l’appartenance à des groupes fréquemment discriminés, incluant les personnes de la diversité sexuelle et de genre, les femmes, les peuples autochtones, les minorités racisées, les jeunes, les personnes dont la santé mentale ou physique est fragilisée,
- des expériences de vie marquées par la rupture des liens sociaux ou les abus physiques, sexuels ou moraux, le retrait du milieu familial (protection de la jeunesse), épisodes d’hospitalisation ou internement (système de santé et psychiatrie, incarcération),
- des troubles liés à la consommation de substances ou à une dépendance, etc.
Quand les portes se ferment, que les facteurs d’exclusion se cumulent, que le réseau de solidarité s’épuise, que les mécanismes de protection de notre société se montrent inaccessibles ou inefficaces, les personnes se retrouvent exclues et marginalisées. Cela leur impose d’adopter des stratégies de survie diverses, mais toutes marquées par l’impossibilité d’avoir un chez-soi stable. L’itinérance n’est pas un choix, c’est une situation subie.
Les personnes en situation d’itinérance vivent largement dans l’espace public ce qui relève habituellement de la sphère privée:
- besoins physiologiques,
- sommeil, hygiène,
- maladie et soins de santé,
- sexualité,
- état de crise, consommation, etc.
Cela entraîne comme conséquences de les exposer au jugement de la population, mais aussi à des sanctions plus fréquentes par les autorités. Elles se trouvent ainsi plus fréquemment judiciarisées que les autres.
L’itinérance ne se limite pas à sa partie visible. Plusieurs vivent une situation d’itinérance que l’on dit invisible ou cachée :
- elles se retrouvent hébergées de manière temporaire chez des connaissances,
- échangent des services sexuels contre un toit,
- louent à la semaine ou au mois une chambre dans des motels, des hôtels, des saunas, des terrains de camping ou dans une maison de chambres, etc.
Que l’itinérance soit visible ou cachée, la pauvreté qui la caractérise constitue un obstacle aux droits de la personne, voire un déni de ces droits.
-
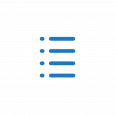
Droits des personnes en situation d'itinérance
Les mêmes droits que tout le monde
Il importe de le rappeler, les personnes en situation d’itinérance ont les mêmes droits et libertés que toute autre personne. La Charte québécoise des droits et libertés de la personne s’applique à toute personne qui se trouve au Québec, qu’elle ait la citoyenneté canadienne ou non. Toute personne peut donc faire valoir les droits que la Charte protège à l’encontre, par exemple, d’une autre personne, d’un commerce ou d’une entreprise privée, d’un organisme communautaire, d’une municipalité, de services policiers, d’une institution gouvernementale ou de l’État québécois.
La Charte établit entre autres que les personnes en situation d’itinérance doivent pouvoir exercer leurs droits en pleine égalité, sans discrimination fondée sur :
- leur condition sociale, la présence d’un « handicap », par exemple une dépendance, un problème de santé physique ou un trouble de santé mentale, le recours à un moyen de pallier un handicap, incluant un chien guide ou d’assistance ;
- leur langue, leur appartenance à une minorité racisée, leur origine ethnique ou nationale (ce qui comprend l’identité autochtone) ou leur religion ;
- leur sexe, leur identité ou expression de genre ou leur orientation sexuelle ;
- leurs convictions politiques, leur état civil, leur état de grossesse ou, sauf exception, leur âge.
Certes, les droits et libertés énoncés dans la Charte ne sont pas absolus. Une loi pourrait entre autres imposer certaines limites à l’exercice d’un droit, si elles sont justifiées pour atteindre un objectif urgent et réel par des moyens qui sont raisonnables et qui, entre autres, portent le moins possible atteinte aux droits. Par exemple, les règles empêchant un automobiliste d’avancer sur un feu rouge ou l’obligeant à attendre le feu piéton pour traverser la rue briment à première vue son droit à la liberté, mais il s’agit de moyens raisonnables pour assurer la sécurité de chacun et chacune.
Parfois, des limites s’imposent aussi quand l’exercice des droits et libertés porte atteinte à ceux d’une autre personne.
Les libertés et droits fondamentaux
Droit à la vie, à la sûreté, à l’intégrité (article 1)
Les personnes en situation d’itinérance AUSSI ont droit à la vie, à la sûreté, à l’intégrité de leur personne.
Les droits à la vie, à la sûreté et à l’intégrité de la personne protègent entre autres contre les actes qui entraînent des conséquences physiques et psychologiques sérieuses, graves ou néfastes sur une personne.
Par exemple, des ordonnances interdisant de rester dans les parcs la nuit pourraient entraîner des conséquences sur l’état de santé déjà préoccupant de certaines personnes en situation d’itinérance.
Toujours à titre d’exemple, une personne ne peut être soumise à des soins de santé sans son consentement, sauf exception.
Droit à la liberté de leur personne (article 1)
Les personnes en situation d’itinérance ont AUSSI droit à la liberté de leur personne.
Cela ne veut pas dire qu’elles peuvent faire tout ce qu’elles veulent ; elles conservent leur autonomie personnelle pour faire des choix fondamentaux en ce qui les concerne.
À titre d’exemple, à l’exception du cas où elles constitueraient une menace pour elles-mêmes ou pour autrui, nul ne peut les obliger à agir contre leur gré ou les garder dans un établissement sans leur consentement.
Toujours à titre d’exemple, une arrestation et une détention injustifiées pourront aussi porter atteinte au droit à la liberté. De même, le recours à une force excessive de la part de personnes en situation d’autorité envers une personne, qu’elle soit ou non en état de crise, pourra constituer une atteinte à un ou plusieurs des droits à la vie, à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.
Personnalité juridique (article 1)
Les personnes en situation d’itinérance AUSSI ont la personnalité juridique.
La personnalité juridique ne dépend pas du lieu de résidence : tout être humain, du seul fait d’être né, possède ce droit. Concrètement, c’est le droit à la personnalité juridique qui fait en sorte qu’on a des droits et des obligations.
Ne pas avoir d’adresse ne devrait pas représenter un obstacle pour accéder aux programmes et aux services publics auxquels une personne a droit, comme l’assistance financière ou des services médicaux.
Droit d’être secourues en cas de péril (article 2)
Les personnes en situation d’itinérance AUSSI ont le droit d’être secourues en cas de péril pour leur vie.
Toute personne témoin de la détresse d’une personne dont la vie est en danger imminent doit lui venir en aide, soit personnellement ou en obtenant des secours, à moins que cela n’engendre un risque pour elle ou pour autrui ou qu’elle ait un autre motif raisonnable pour ne pas le faire.
Liberté de conscience, de religion, d’opinion, d’expression, de réunion pacifique et d’association (article 3)
Les personnes en situation d’itinérance AUSSI ont des libertés fondamentales : liberté de conscience, de religion, d’opinion, d’expression, de réunion pacifique et d’association.
Les modes d’expression protégés par la Charte peuvent prendre différentes formes, incluant par exemple l’art, le fait de participer à une manifestation ou à un mouvement de contestation social pacifiques, d’opter pour un style vestimentaire ou de coiffure particulier, d’avoir un ou des tatouages, des piercings, etc.
L’expression publique de la colère ou du désarroi, bien que souvent décriée comme dérangeant l’ordre public, peut aussi être protégée par la liberté d’expression. La liberté d’expression n’est toutefois pas absolue et elle peut être limitée, par exemple lorsqu’il s’agit de violence, de menace de violence ou d’incitation à la violence.
Droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation (article 4)
Les personnes en situation d’itinérance AUSSI ont droit qu’on respecte leur dignité, leur honneur et leur réputation.
La dignité est bafouée lorsqu’on traite une personne d’une façon qui la prive de son humanité par des traitements qui l’humilient ou la dégradent. Par exemple, vivre en situation de pauvreté ou ne pas pouvoir combler le besoin fondamental de se loger constitue des atteintes au droit à la sauvegarde de sa dignité. La privation d’accès à des installations sanitaires et à de l’eau potable pourrait aussi relever d’un déni du droit à la sauvegarde de sa dignité.
Des directives, des politiques ou des pratiques qui auraient un impact négatif disproportionné sur les personnes en situation d’itinérance et auraient pour effet de les exclure de l’espace public, pourraient aussi porter atteinte à la sauvegarde de leur dignité. Ce pourrait être le cas, par exemple, d’un règlement municipal qui sanctionne le seul fait de s’étendre ou de dormir sur un banc de parc sans entraîner de nuisance.
Toujours à titre d’exemples, l’usage d’une force excessive de la part de policiers, une détention injustifiée ou encore des interventions infantilisantes ou humiliantes ou qui ne respectent pas l’autonomie des personnes en situation d’itinérance sont à éviter.
Proférer des propos menaçants et dégradants à l’endroit d’une personne en situation d’itinérance peut aussi porter atteinte au droit à la sauvegarde de sa dignité en toute égalité.
Droit au respect de sa vie privée (article 5)
Les personnes en situation d’itinérance AUSSI ont droit au respect de leur vie privée.
Le droit à la sauvegarde de sa vie privée inclut différentes composantes, dont la protection des renseignements personnels comme le nom, la date de naissance ou les renseignements médicaux. Intervenir auprès d’une personne en situation d’itinérance ou interagir avec elle implique de ne lui demander que les renseignements personnels nécessaires à l’intervention et de ne pas les communiquer sans son consentement, à moins que la loi le permette. Par exemple, obliger une personne en situation d’itinérance à produire des pièces d’identité sans justification ou en se fondant sur des pratiques de profilage social restreint le droit à la vie privée. Le respect de ce droit inclut aussi de bien protéger les renseignements confiés par la personne lors d’échanges entre intervenants.
Le droit à l’image est également compris dans la sphère d’intimité personnelle protégée par le droit à la sauvegarde de sa vie privée. Sauf exception, on ne peut photographier ou filmer une personne et diffuser son image sans son consentement.
Autre exemple, le droit au respect de sa vie privée inclut le fait de prendre des décisions fondamentalement personnelles sans influence extérieure indue, comme le droit de choisir où on souhaite vivre.
Droit à la jouissance paisible (articles 6, 7 et 8)
Les personnes en situation d’itinérance AUSSI ont droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de leurs biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. Leur demeure AUSSI est inviolable et nul ne peut y entrer ou y prendre quoi que ce soit sans leur consentement.
Le droit à la jouissance et à la libre disposition de ses biens offre une protection du droit de propriété individuelle, mais certaines limites ont été imposées à ce droit pour assurer aussi le respect des locataires et corriger l’inégalité dans les rapports de force entre le locateur et le locataire. Ces règles imposent par exemple des conditions à respecter pour un locateur qui veut évincer un locataire.
Les agents qui transigent avec les personnes en situation d’itinérance doivent également veiller à ne pas jeter leurs biens par mégarde, par exemple en les confondant avec des « ordures ».
À propos des campements ou abris de fortune
Les campements ou autres abris temporaires installés par des personnes en situation d’itinérance font couler de plus en plus d’encre, mais bien peu d’interventions les abordent en se fondant sur les droits garantis par la Charte. Pourtant, l’existence même de ces campements, les conditions de vie qu’on y retrouve ainsi que la réponse que la société doit y apporter sont toutes des questions de droits de la personne. C’est sur la base de ces droits qu’il convient d’agir.
On doit notamment les aborder en tenant compte :
- du droit à la vie, à la sûreté et à l’intégrité de sa personne (art. 1) ;
- du droit à la sauvegarde de sa dignité (art. 4) ;
- du droit au respect de sa vie privée (art. 5) ;
- du droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens (art. 6) ;
- du droit à l’inviolabilité de la demeure (art. 7) ;
- du droit à l’égalité et à l’interdiction de profilage social ou d’autres formes de discrimination (art. 10) ;
- de l’interdiction de harcèlement discriminatoire (art. 10.1) ;
- du droit à des mesures d’assistance financière et à des mesures sociales susceptibles d’assurer un niveau de vie décent (art. 45).
Le droit au logement est aussi implicitement reconnu par la Charte (art. 45). Selon le droit international, ce droit implique un logement adéquat, c’est-à-dire un logement :
- sécuritaire ;
- abordable ;
- habitable ;
- accessible ;
- culturellement adéquat ;
- dans un endroit approprié ;
- et qui permet d’assurer l’accès aux services de base.
L’existence des campements et les conditions de vie des personnes qui y résident
Les campements ne sont ni une solution à l’itinérance ni un logement adéquat. Mais, les options de logement respectueuses de l’ensemble des droits de la personne manquent pour une partie grandissante de la population et les campements représentent alors la seule alternative. Il s’agit d’une stratégie de survie pour les personnes en situation d’itinérance, mais aussi une manifestation de la discrimination systémique et de l’exclusion sociale qu’elles vivent.
Comme l’a fait la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur le droit à un logement convenable, il convient de rappeler l’obligation de l’État d’assurer la mise en œuvre du droit à un logement convenable, mais aussi l’importance d’assurer le respect des droits des personnes qui résident dans ces campements alors qu’ils attendent des solutions de logement adéquates et abordables qui puissent répondre à leurs besoins.
La réponse des autorités aux campements
Les réponses offertes à la multiplication des campements diffèrent en fonction des municipalités ou autres niveaux de gouvernement, mais elles ont trop souvent pour effet de pénaliser les personnes qui y résident et de les placer dans une situation encore plus précaire et marginalisée qu’elles ne l’étaient. Sauf exception, le droit international des droits de la personne interdit d’ailleurs les expulsions forcées des campements de personnes en situation d’itinérance, notamment sans qu’elles puissent avoir accès à un logement adéquat. La jurisprudence au Canada s’appuie d’ailleurs sur ces principes.
Plus largement, une approche réellement basée sur les droits implique la participation des personnes qui résident dans les campements dans l’identification et la mise en place de réelles alternatives à ceux-ci.
Droit au secret professionnel (article 9)
Les personnes en situation d’itinérance AUSSI ont droit au secret professionnel.
Le droit au secret professionnel vise l’ensemble des services offerts par une personne membre d’un ordre professionnel, comme les médecins, les infirmières, les avocats, les huissiers de justice, les dentistes, les pharmaciens, les travailleurs sociaux et les psychologues. Comme toute personne, les personnes en situation d’itinérance ont le droit de recevoir des services professionnels en toute confidentialité. Cela leur permet, par exemple, de recevoir les soins de santé ou les services sociaux dont elles ont besoin en toute confiance.
Une personne tenue au secret professionnel ne peut dévoiler ou partager les informations obtenues sans obtenir le consentement libre et éclairé de la personne en situation d’itinérance, ou y être autorisée par la loi. On parle, par exemple, des informations contenues dans un dossier médical, psychiatrique ou psychologique. Pour être libre et éclairé, le consentement doit remplir certaines conditions. Il doit, entre autres, être explicite. Il doit aussi avoir été donné à des fins spécifiques (et non de façon générale) et en connaissance de cause. Cela exige par exemple que la personne en situation d’itinérance connaisse les informations que le professionnel souhaite communiquer, à qui et pour quel usage.
Cela dit, la loi permet aux professionnels de communiquer des renseignements confidentiels dans certaines circonstances, par exemple lors de situations d’urgence où il existe un risque sérieux de mort ou d’atteinte grave à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
Le droit à l’égalité
Les personnes en situation d’itinérance AUSSI ont le droit à l’égalité dans la reconnaissance et l’exercice de leurs droits et de leurs libertés (article 10).
Ce droit à l’égalité entraîne une interdiction de discriminer :
- De manière directe, c’est-à-dire en exerçant une exclusion ou une distinction ouvertement basée sur des critères discriminatoires.
Par exemple, refuser l’accès à un établissement ou à un centre commercial à une personne parce qu’elle est perçue comme étant itinérante ou exiger plus de preuves d’identité à cette personne que ne le prévoit la procédure habituelle pour octroyer un bien ou un service peut constituer de la discrimination directement fondée sur la condition sociale. - De manière indirecte, en appliquant une règle, une norme ou une pratique qui a l’air neutre et s’applique à tout le monde, mais qui a un effet négatif disproportionné sur certaines personnes du fait de leur condition sociale ou de tout autre motif interdit de discrimination.
Par exemple, l’obligation de s’inscrire au dépôt direct pour obtenir le versement d’une aide financière comme un crédit d’impôt peut constituer une discrimination indirecte pour les personnes en situation d’itinérance qui sont plus nombreuses à ne pas avoir un compte bancaire.
L’obligation d’accommodement raisonnable
Quand un obstacle discriminatoire survient dans l’application d’une norme ou d’une pratique générale, le décideur a l’obligation de chercher un accommodement raisonnable. Par exemple, offrir une alternative à l’obligation de fournir une adresse postale pour l’ouverture du dossier de santé d’une personne n’ayant pas d’adresse pourrait être un accommodement raisonnable qui lui permet d’avoir accès aux services d’une clinique et aux soins dont elle a besoin. En contexte policier, cette obligation d’accommodement raisonnable implique entre autres d’adapter l’intervention policière face à une personne en situation de vulnérabilité. Pour ce faire, il faut adopter une approche personnalisée, et non se fonder sur des préjugés, des stéréotypes ou des suppositions.
- De manière systémique, c’est-à-dire quand un ensemble de règles, de normes et de pratiques a un effet d’exclusion plus grand sur un groupe de personnes. Cela peut être le cas lorsque, même sans mauvaise intention, des règles ou des pratiques ont été mises en place sans tenir compte de certaines caractéristiques, comme le fait de vivre en situation d’itinérance. La discrimination systémique peut également être fondée sur des préjugés et des stéréotypes, mais elle contribue aussi à les reproduire et perpétuer.
Par exemple, le profilage social est une discrimination systémique visant les personnes en situation d’itinérance. L'interaction des lois, des règlements municipaux, des normes et des pratiques policières qui pénalisent des comportements jugés inappropriés dans l’espace public, tel que flâner, uriner sur la voie publique ou occuper plus d’une place sur un banc a un effet disproportionné sur les personnes en situation d’itinérance. Conséquence, celles-ci reçoivent un nombre disproportionné de constats d’infraction, entraînant des contacts disproportionnés entre elles et le système de justice, en fonction de leur condition sociale. Le fait que les personnes qui souffrent d’un problème de santé mentale sont surreprésentées dans le système de justice criminelle et parmi les personnes emprisonnées peut aussi être un exemple de discrimination systémique.
Précisions sur certains motifs interdits de discrimination
La situation d’itinérance n’apparait pas explicitement parmi les 14 motifs interdits de discrimination inscrits dans la Charte. Le motif condition sociale couvre cependant le fait d’être en situation de pauvreté ou d’itinérance ou encore de mendier, par exemple.
- le motif condition sociale réfère au rang ou à la place qu’une personne occupe dans la société en fonction de différents facteurs comme son éducation, ses revenus, son occupation, mais aussi en fonction des perceptions que la société entretient face à ces facteurs. Il s’agit d’une position plus subie que choisie.
Il faut aussi bien comprendre la portée des deux motifs liés au handicap :
- Le handicap est défini largement et comprend diverses situations. Il peut être temporaire, épisodique ou persistant. Il peut découler d’une maladie ou d’une limitation physique, psychologique ou cognitive, qu’elle soit réelle ou fondée sur les préjugés que les gens ont à notre endroit. Cela inclut les troubles de santé mentale et les dépendances comme la toxicomanie/alcoolisme. Les approches fondées sur des préjugés qui ont pour effet de condamner, sanctionner ou judiciariser l’alcoolisme et la toxicomanie peuvent donc contribuer à la discrimination.
- Le moyen de pallier ce handicap est également défini largement et inclut divers moyens, comme un chien guide ou d’assistance, la prise de médication, le recours à un dispositif physique tel un appareil auditif, une canne, un fauteuil roulant, le recours à un interprète LSQ ou à la traduction en braille, etc.
Être en situation d’itinérance peut par ailleurs impliquer plusieurs autres motifs de discrimination, qui peuvent varier d’une personne à l’autre et s’entrecroiser de diverses manières. On parle alors souvent d’analyse intersectionnelle.
Pensons, par exemple :
- au motif sexe qui peut être lié aux enjeux spécifiques de sécurité et d’intégrité physique et psychologique que le profilage social peut poser pour les femmes ;
- au motif âge à considérer en lien avec les réalités des jeunes, notamment des jeunes plus à risque de se retrouver en situation d’itinérance lorsque prend fin un placement en milieu de vie substitut en protection de la jeunesse lors du passage à la vie adulte ;
- aux motif « race », couleur et origine ethnique ou nationale qui renvoient aux personnes autochtones, aux personnes racisées et aux personnes immigrantes pour qui le profilage social peut se croiser avec le profilage racial.
- au motif identité ou expression de genre qui peut être lié aux enjeux propres aux personnes trans ou non binaires, par exemple lorsque l’accès à certains lieux ou espaces est conditionné à diverses formes, non nécessaires, de vérification du sexe ou de l’identité de genre.
Important : les préjugés peuvent être inconscients et entraîner une discrimination même sans qu’il y ait intention de le faire.
Une personne peut aussi être discriminée même si elle n’est pas réellement en situation d’itinérance, mais parce qu’on la juge comme telle sur la base de préjugés et de stéréotypes.
Les personnes en situation d’itinérance AUSSI ont le droit d’être protégées contre le harcèlement discriminatoire (article 10.1).
Le harcèlement discriminatoire est lié à un ou plusieurs des motifs de discrimination qui sont énumérés à la Charte, comme la condition sociale d’une personne. Il peut prendre différentes formes, à travers des commentaires ou des comportements non désirés qui sont vexatoires, méprisants, hostiles, injurieux ou haineux. C’est généralement la répétition de paroles ou de comportements offensants qui créent le harcèlement. Parfois, un seul acte grave peut constituer du harcèlement. C’est le cas si cet acte entraîne un effet nocif et continu sur la personne qui le subit.
Par exemple, la remise de contraventions à une personne en situation d’itinérance, à répétition et sur un court laps de temps par le même policier peut s’apparenter à du harcèlement discriminatoire. Ce pourrait aussi être le cas si une personne en situation d’itinérance doit subir les interventions répétées de la part de policiers à travers une surveillance particulière, de nombreuses paroles ou interactions et de multiples contraventions.
Autre exemple, les plaintes répétées d’une personne aux services de police afin de faire déloger une personne en situation d’itinérance, sur la base de préjugés et sans que cette dernière n’entraîne une nuisance ou une menace, pourraient aussi constituer du harcèlement discriminatoire.
Personne ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe qui discrimine une personne en situation d’itinérance ou autorisée à le faire (article 11).
L’avis, l’affiche, le symbole ou le signe dont on parle ici peut être autant matériel que virtuel, et publié dans une fenêtre, sur Internet, dans un journal, etc.
Par exemple, on ne peut indiquer dans une annonce de location de logement qu’il faut « un emploi stable », « non aux sans-emplois » ou que les personnes inscrites à un programme d’aide sociale doivent « s’abstenir ».
Une affiche qui interdirait de flâner dans l’espace public, sans référer à une entrave ou une autre nuisance, pourrait également avoir un effet discriminatoire pour les personnes en situation d’itinérance et être contraire à la Charte.
Les personnes en situation d’itinérance AUSSI peuvent avoir accès aux biens et services ordinairement offerts au public (article 12).
Par exemple, un commerce, ou les services de sécurité qui y œuvrent ne pourraient expulser les personnes jugées « suspectes » ou « indésirables » seulement parce qu’elles affichent des signes extérieurs de pauvreté.
Les services policiers sont reconnus comme étant un service ordinairement offert au public. Ils doivent donc adapter leurs pratiques pour ne pas entraîner de discrimination ou de profilage discriminatoire envers les personnes en situation de pauvreté ou les personnes qui ont un trouble de santé mentale. Par exemple, un policier qui remettrait des contraventions à répétition à une personne en situation d’itinérance pour l’inciter à quitter l’espace public pourrait contrevenir à cet article.
Par ailleurs, la prestation offerte par les services policiers ne devrait pas être moindre ou entachée de préjugés. Par exemple, les personnes en situation d’itinérance ne devraient pas craindre de faire appel à la police en cas de besoin, d’être moins protégées ou de ne pas être prises au sérieux lorsqu’elles sont victimes d’un crime.Les personnes en situation d’itinérance AUSSI sont protégées contre les clauses d’un contrat comportant discrimination (article 13).
Le contrat (ou l’acte juridique) dont il est question à cet article peut prendre différentes formes, par exemple un bail de logement. Le propriétaire d’un logement ne pourrait donc pas gonfler le prix de location d’un logement dans le but de décourager un candidat-locataire sur la base de préjugés, sans égard à sa réelle capacité de payer.
La personne qui loue une seule chambre dans sa propre résidence n’est pas concernée par les deux énoncés précédents (aux articles 12 et 13) si elle n’annonce pas la chambre à louer publiquement (babillard, annonce, Internet et médias sociaux…) (article 14).
Mise à part cette exception, les propriétaires ne peuvent exercer de discrimination à l’endroit de locataires potentiels du fait de leur situation d’itinérance. Les propriétaires ou concierges de maisons de chambre ne peuvent faire valoir cette exception pour justifier une sélection discriminatoire.
Les personnes en situation d’itinérance AUSSI ont le droit d’avoir accès sans discrimination aux moyens de transport ou lieux publics comme les commerces, restaurants, parcs et autres pour y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles (article 15).
Des lieux comme des toilettes publiques, une piscine ou une bibliothèque municipale, un centre commercial, un parc ou une gare et des moyens de transport comme un autobus, un métro ou un train doivent tous être accessibles aux personnes en situation d’itinérance comme à toute personne, sans discrimination.
Des normes ou des pratiques qui ont un impact disproportionné sur les personnes en situation d’itinérance dans l’espace public peuvent être contraires à cet article. Par exemple, l’interdiction d’accéder aux parcs la nuit pourrait compromettre l’accès aux lieux publics sans discrimination pour les personnes en situation d’itinérance. Un règlement de bibliothèque municipale qui interdirait l’accès à des usagers sur la base de leur hygiène corporelle pourrait aussi porter atteinte au droit d’avoir accès aux lieux publics sans discrimination.
Les personnes en situation d’itinérance AUSSI ont le droit de ne pas être discriminées en emploi : l’affichage d’emploi, le processus de sélection, l’embauche, la formation professionnelle, la promotion, une suspension, le renvoi et les conditions de travail doivent entre autres être exempts de discrimination. Cette interdiction est aussi valable pour une agence de placement de personnel (articles 16 à 19).
Par exemple, un employeur qui déciderait de ne pas embaucher une personne compétente en se basant sur son apparence, sa mauvaise condition dentaire ou l’état de ses chaussures, pourrait s’exposer à une plainte en matière de discrimination. Un employeur qui offrirait à une personne en situation d’itinérance des conditions de travail moins avantageuses que celles des autres employés pour accomplir le même travail pourrait aussi contrevenir à la Charte.
Un employeur ne peut non plus congédier, refuser d’embaucher ou pénaliser une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction, si celle-ci n’a aucun lien avec l’emploi ou si la personne en a obtenu le pardon.
Les organismes sans but lucratif (à caractère charitable, philanthropique, éducatif, etc.) et qui sont exclusivement voués à venir en aide aux personnes en situation d’itinérance ou de vulnérabilité ne sont pas réputés exercer de discrimination en réservant leurs services à ces personnes (article 20).
Par exemple, un organisme sans but lucratif offrant du logement peut avoir des critères d’admissibilité pour réserver ses services à des personnes en situation d’itinérance lorsque c’est en lien avec sa mission.
-

Intervenir pour défendre les droits des personnes en situation d'itinérance
Toute intervention, même ponctuelle, auprès d’une personne en situation d’itinérance, devrait viser à rétablir ou protéger ses droits et sa dignité. À l’inverse, toute intervention fondée, consciemment ou non, sur les préjugés et les stéréotypes est à éviter. C’est le cas, par exemple, lorsqu’on considère les personnes en situation d’itinérance comme étant paresseuses, nuisibles, dangereuses, déviantes ou criminelles et lorsque les interventions suivent une approche misérabiliste, infantilisante ou incapacitante. Recours en cas de discrimination ou de harcèlement
Vous pensez avoir fait l’objet de discrimination ou de harcèlement discriminatoire? La Commission des droits peut recevoir votre plainte.
Porter plainte pour discrimination ou harcèlement
Voici aussi quelques autres recours à connaitre :
- Protecteur du citoyen : Pour porter plainte à l'égard d'un ministère ou d'un organisme public OU Porter plainte ou faire un signalement à l'égard du réseau de la santé et des services sociaux.
- Commission d’accès à l’information : Pour contester ou porter plainte si vous avez demandé par écrit l'accès à vos renseignements personnels ou leur rectification sans obtenir de réponse OU si vous avez exercé un autre droit relatif à vos renseignements personnels et êtes insatisfait de la réponse d'un organisme public ou d'une entreprise.
- Commissaire à la déontologie policière : Pour porter plainte ou faire un signalement concernant des agent(e)s de la paix qui auraient dérogé à un devoir prévu au Code de déontologie des policiers du Québec.
Le document Les personnes en situation d’itinérance ont des droits: aide-mémoire à l’attention des personnes qui côtoient les personnes en situation d’itinérance dans leurs fonctions ou dans leur vie de tous les jours sur lequel est basée cette page est disponible en format PDF.
Notre avis sur ...
Cette page présente les droits des personnes en situation d'itinérance reconnus dans les deux premiers chapitres de la Charte des droits et libertés de la personne, qui couvrent les libertés et droits fondamentaux ainsi que le droit à l’égalité. Une version bonifiée suivra et couvrira également les droits politiques, les droits judiciaires et les droits économiques et sociaux qui leur sont garantis par la Charte.
Vous avez des questions ?
Contactez la Direction de l’éducation et de la promotion des droits de la Commission : education@cdpdj.qc.ca
